Générique (du latin genus, -eris : origine, famille, sang, lignée) : présentation d’un film, faisant partie de la bande cinématographique, où sont mentionnés, par image ou son, en début et/ou fin, les noms des producteurs, auteurs, acteurs et techniciens.
Je vous conseille deux sites très intéressants sur les génériques :
We Love Your Names : une base de données de génériques de cinéma et de télévision, très riche.
Art of The Title : site proposant des interviews des génies derrière la création des génériques (de films, séries télé, jeux vidéo) et des analyses de leur processus créatifs.
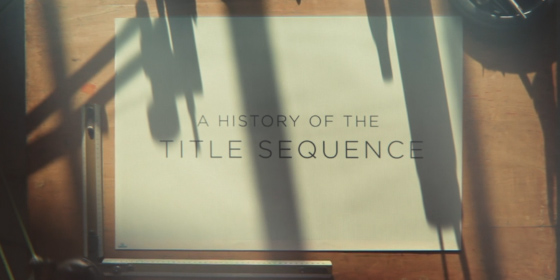
Le cinéma dans son ensemble (et y compris son infrastructure), est une histoire de franchissement de portes, de passages de sas, de rituels.
Le générique de fin est un sas, un rituel pour sortir de l’univers diégétique et rentrer à nouveau dans la vie. De même, le générique de début permet de rentrer dans l’univers diégétique (comme le petit sas sombre entre le hall du cinéma et la salle, ou le passage d’une salle éclairée à une lumière tamisée puis au noir complet).
En 1895, à la naissance du cinématographe, le générique tel qu’on le connaît aujourd’hui n’existe pas. Ce n’est que progressivement que le générique prend une place fonctionnelle, légale, puis artistique au sein des productions cinématographiques, jusqu’à transcender la mythologie du cinéma et devenir des manifestes artistiques et avant-gardistes.
Naissance du générique : 1900-1950
1900-1910’s : Des cartons et affirmations
Le cinéma des débuts est souvent qualifié de « non-clôturé » tant la présentation du film incombe à l’époque au projectionniste ou à l’exploitant. Le titre est alors régulièrement projeté par une lanterne magique.
Il y a une véritable carence nominative des interprètes (le film a toujours statut de film de foire), et une volonté farouche des maisons de production de s’attribuer la paternité des films. Pour lutter contre le piratage (déjà) notamment des copyrights, elles décident d’envahir le décor du film de leurs emblèmes (un coq, une marguerite, un étoile noire).
Le montage n’est qu’à ses balbutiements, on commence à voir apparaître des cartons informatifs dans les films, notamment pour le titre du film et la société de production. Le premier tournant a lieu en 1903, quand Edwin Porter introduit Le Vol du grand rapide par un fragment d’introduction : un panneau avec le titre et le copyright.
1910’s : Généralisation des longs-métrages et revendications
Face au succès populaire et commercial de nombreux films de l’époque, des revendications de la part des divers participants aux films émergent. Les interprètes et les réalisateurs entendent enfin faire valoir leurs noms (leur personne, leur travail et leur métier). Jusque-là, les réalisateurs n’avaient pas le droit d’être mentionnés comme responsables artistiques des films.
On voit donc peu à peu les interprètes saluer les spectateurs à l’écran, puis Chaplin et Griffith imposent le nom du cinéaste à l’écran. Après de nombreux pourparlers, les interprètes y auront eux aussi le droit par la suite.
1920-1940’s : Entre grisaille et in(ter)ventions
La musique a toujours eu une influence sur le cinéma : avant le parlant, les projections étaient souvent précédées d’ « ouvertures musicales » qui faisaient la transition entre le générique projeté et le film.
L’arrivée du sonore marque aussi l’émergence des logos des studios accompagnés de leur fanfare (composée par les compositeurs stars de l’époque, comme Waxman ou Newman).
Les génériques sur fond gris pullulent et deviennent la norme officielle du générique. Cependant des tentatives naissent pour réinventer le générique (comme dans Roman d’un tricheur ou La Belle et la Bête). Le générique devient plus que jamais lieu d’inventions, des premiers trucages, certains toujours employés aujourd’hui.
Le star-system est en marche, avec malheureusement ses discriminations, signe des temps obscurs à venir : Lucas Gridoux (Slimane de Pépé le Moko) ou Walter Reisch (réalisateur de Episode) ne sont soit pas cités, soit rabaissés car d’origine juives, ou d’autres pour être arabes, etc.
Lettres de noblesse du générique : 1950-1960
Une véritable dynamique s’opère autour des génériques, avec des graphistes, des dessinateurs, mais d’où émerge aussi les questions de genre, de fragmentation et de résistance.
1950’s : Dynamique des génériques
En partie grâce à l’impulsion des génériques d’animation inventifs de Norman McLaren, le générique d’ouverture au cinéma se meut. Il dynamise le film, soumis qu’il est à la concurrence de la télévision et au décret anti-trust.
Le générique de Carmen Jones d’Otto Preminger marque une date-clé.
1960’s : Grande époque des génériques animés
Une génération entière de graphistes, de dessinateurs et de caricaturistes s’affairent à donner vie et couleurs aux génériques. Ceux de fin s’allongent progressivement, émiettant les mentions obligatoires ; les pré-génériques se multiplient et les split-screen se taillent la part du lion. C’est le temps des fragmentations du film.
En France, Jean Fouchet imagine des génériques enlevés pour Fantômas, pendant que Jean-Luc Godard, en résistance, revient aux cartons primitifs.
Au Royaume-Uni, aux USA, DePatie et Freleng, ou Maurice Binder (James Bond) marquent de leur nom le générique.
On commence à composer spécifiquement pour le générique.
1970-1990’s : Générique contemporain
Emerge alors l’avènement des ordinateurs dans la création des génériques, des jeux sur les logos.
Après l’aventure technologique de Star Wars (le fameux crawl de Dan Perri), le générique de Superman par les frères Greenberg est une nouvelle étape : le générique entre dans une nouvelle ère, où les possibilités visuelles et sonores sont décuplées, pour le meilleur et pour le pire.
1990’s : Renaissance du générique
Des pionniers comme Saul Bass (surtout connu pour ses génériques de certains Hitchcock ou d’Otto Preminger, qui révolutionnèrent le générique de cinéma) sont à nouveau sollicités pour le cinéma, tout comme Pablo Ferro.
On voit également l’émergence de nouvelles stars : Randy Balsmeyer (génériques des films de Spike Lee, des frères Coen, de Jim Jarmusch), Robert Dawson (le concepteur inconnu qui se cache derrière les célèbres génériques des films de Tim Burton), ou Kyle Cooper (Seven, Mimic, L’Armée des Morts, c’est lui, ainsi que The Walking Dead ou American Horror Story pour la télévision).
2000’s : Inflation des détournements de logos
S’il est un réalisateur aux logos détournés dans ses films, c’est bien Tim Burton. D’un 20th Century Fox gelés dans une boule à neige dans Edward aux Mains d’Argent, au logo de la Warner menacé par des extraterrestres dans Mars Attacks, en passant par l’électrocution du logo Touchstone dans Ed Wood, en passant sous silence bien d’autres détournements.
Mais ce n’est pas seulement le logo, c’est le générique dans sa totalité qui est travaillé.
Tim Burton est un cinéaste hollywoodien issu de Disney. Il œuvre donc au sein du « Studio system », mais n’en demeure pas moins auteur.
La majorité des films de Burton débute par le son avant l’image (comme nous entendons avant de naître). La partition musicale de Danny Elfman le fait naître.
Il se plaît à détourner le logo inaugural, semblable à un tampon administratif. Il transforme le symbole, la multinationale, en objet miniature ou en un lieu réel susceptible de subir les intempéries ou les enveloppe de magie.
Profondément conscient d’une Amérique défigurée par les marques (je vous conseille d’ailleurs fortement la lecture de No Logo de Naomi Klein à ce sujet), Burton affiche une fascination pour le design (des signes, sigles, sceaux familiaux) et tente de subvertir une industrie cinématographique et une iconographie aujourd’hui galvaudées.
Signés par le graphiste Robert Dawson, les génériques des films de Burton mélangent industrie et artisanat, technologie et bricolage.
Quand il ne s’agit pas a priori de fabrication (et au fond, de genèse, de génétique), Burton dévoile à la façon d’un conte la généalogie ou le destin familial.
Tous ses génériques sont semblables aux miroirs d’Alice : nous traversons des univers de miniatures et de trompe-l’œil. Les formes et les couleurs, leur cohérence, sont souvent difficiles à décoder puis deviennent subitement compréhensible, tel que dans La Planète des Singes ou le logo de Batman.
Les génériques de Burton ont un pouvoir poétique, à raconter des histoires, des traversées, des révélations ; ils préparent les spectateurs à un monde préfabriqué de faux semblants.
Tim Burton doit beaucoup au tournant graphiques des années 50-60, où les génériques étaient plus animés et attractifs. Il revendique une filiation à l’Histoire du générique (ceux de Saul Bass notamment) et aux idées graphiques de Ken Strickfaden). Idem pour le détournement des génériques.
Il y a aussi une filiation à l’histoire plus intime, d’éléments qui ont fait le cinéma de l’enfance de Burton (les calques Ed Wood/Bella Lugosi, Burton lui-même/Vincent Price), sans compter les multiples apparitions de Christopher Lee dans les films souvent mélancoliques de Burton.
D’où une scénographie de la mort (les cimetières de Frankenweenie ou d’Ed Wood), dans Sleepy Hollow les noms des interprètes sont sur des feuilles mortes qui tombent lentement. La musique d’Elfman complète le générique filial de Burton (les références musicales traversent son univers et le transcendent par le haut).
L’irrévérence envers les logos (et donc les grosses sociétés de production derrière) et l’attachement pour les génériques audiovisuels marquants font de Burton un cinéaste à part. Il donne aux génériques une dimension génétique et généalogique. Ils sont à la fois une déclaration d’indépendance et de dépendances.

